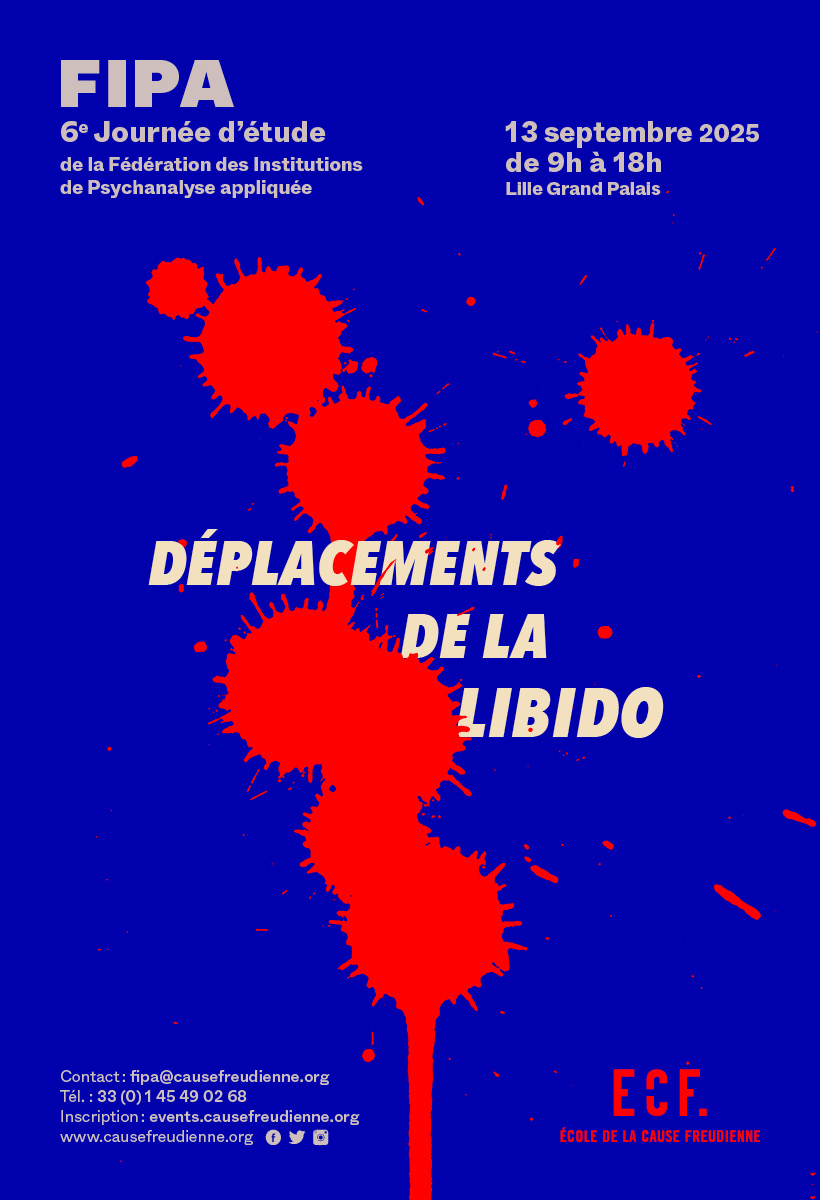Le samedi de 14h à 15h30, trois ateliers avec Christelle Sandras et Michel Grollier ; Ariane Oger et Emmanuelle Borgnis-Desbordes; Danièle Olive et Anne-Marie Le Mercier
La clinique analytique contemporaine et les pouvoirs de l’imaginaire
Le narcissisme et ses versions contemporaines
Lacan, avec le stade du miroir, ramasse le concept freudien de narcissisme et décrit ce moment où le moi se constitue et trouve son fondement dans l’image du corps propre. Tout à la fois identification et satisfaction de l’unité, cette image comble un manque situé comme une faille entre l’être et le moi [1]. D’assumer son image, le sujet se trouve transformé et cette opération sera reliée par Lacan à la présence, dans le miroir, du regard de l’Autre, regard qui reste voilé dans l’image. Des phénomènes cliniques variés, allant du soin apporté à l’image à la négligence, de l’infatuation au sentiment d’intrusion, ou encore au ressenti de détachement du corps… s’éclairent de ce rapport du sujet « avec l’idée de soi comme corps » [2].
Lien de l’imaginaire et de la sublimation
Lacan, dans son Séminaire iv, dégage de l’œuvre de Léonard de Vinci et du texte de Freud, le lien structural de la sublimation et de l’imaginaire [3] Dans le Séminaire vii, la sublimation, articulée au concept de jouissance, consiste à mettre à la place du vide de la Chose un « objet » qui opère comme leurre et dont la dame de l’amour courtois est un paradigme. L’imaginaire conjugué au symbolique y prend alors fonction de voile. Lacan distinguera finalement la jouissance en jeu dans le sinthome de celle incluse dans la sublimation, sous la forme del’escabeau défini comme « ce sur quoi le parlêtre se hisse, monte, pour se faire beau […] piédestal qui lui permet de s’élever lui-même à la dignité de la Chose [4] ». Au fil de ce mouvement la sublimation comme manipulation de l’image se distingue du narcissisme comme adoration de l’image. [5]
Sous l’image, la castration
Dans son texte « Un trouble de mémoire sur l’Acropole » [6], Freud rapporte, alors qu’il se trouvé avec son frère sur l’Acropole, avoir eu cette pensée : « Tout cela n’est pas réel ». Son analyse le conduit de la culpabilité d’avoir dépassé le père, au -φ de la castration qui le concerne aussi bien, et qui est ce qui élidé par le champ scopique [7]. La prise en compte de l’objet a, dégagé par Lacan dans son Séminaire xi, permettra de déceler, derrière la beauté de l’image, le regard du père. La clinique ne manque pas de ces phénomènes d’inquiétante étrangeté, qu’ils accompagnent un sentiment de déjà-vu, surgissent de rêves éveillés ou non, ou bien encore de cauchemars.
L’objet derrière l’image. Fantasme, délire et puissance de l’imaginaire
Freud dans son texte « La perte de la réalité dans la névrose ou dans la psychose » [8] nous conduit déjà à la réalité comme à une construction. Puis Lacan, toujours dans son Séminaire xi, s’efforce de concevoir le champ scopique à partir de la pulsion, nous introduisant à la schize entre la vision et le regard. J.-A. Miller, quant à lui, nous invite à ne pas perdre de vue la fonction de défense du fantasme [9], ajoutons-y celle du délire, ou encore celle de l’inhibition comme réponse impliquant l’imaginaire face à la rencontre traumatique avec le réel.
Le trou dans l’image : après l’évaporation du père retour de l’imaginaire dans le traitement du corps
Dans son séminaire « Politique des identités, politique du symptôme » [10], Marie-Hélène Brousse relève que le tout dernier enseignement de Lacan met moins l’accent sur l’identification du sujet en tant que représenté par un signifiant pour un autre signifiant, que sur l’appartenance, la propriété. « À la place de l’amour pour le père, vient l’adoration du corps ». Lacan en 1974 fait ce constat : « L’homme aime son image comme ce qui lui est le plus prochain, c’est-à-dire son corps, seulement son corps il n’en a aucune idée, il croit que c’est moi. C’est un trou, et puis au dehors, il y a l’image, et avec cette image il fait le monde [11]».
Dans ce fil, J.-A. Miller introduit dans son texte sur la psychose ordinaire, l’externalité corporelle : « Vous n’êtes pas un corps, vous avez un corps, ce qui dans l’hystérie se traduit par l’expérience d’étrangeté du corps, avec dans la psychose ordinaire quelque chose de plus, […] cette brèche dans laquelle le corps se défait et où le sujet est amené à inventer des serre-joints pour tenir avec son corps [12] ».
Versions politiques contemporaines de la puissance de l’imaginaire
L’image à l’âge de la science, plus forte que le réel des corps, commande à leur transformation, pendant que la multiplication des écrans, véritable pousse à la monstration, se double d’une volonté de transparence au-delà de toute pudeur.
Plus loin, sous l’extension de la reconnaissance faciale, pointe l’omniprésence d’un regard et l’ombre grandissante d’une société de surveillance.
Enfin, à l’heure de la politique des identités, quelle place accorder à l’imaginaire dans la montée des populismes et des fascismes, ainsi que dans la pluralisation des ségrégations ?
Lacan ne disqualifie pas l’imaginaire. Il forge la catégorie de semblant [13], mixte d’imaginaire et de symbolique, pour un usage qui, loin de faire oublier le réel, permet de le cerner.
Les six séquences de l’année déclineront :
- Le narcissisme et ses versions contemporaines – 22 novembre 2025
- La sublimation – 13 décembre 2025
- Inquiétantes étrangetés – 10 janvier 2026
- Fantasme, délire et puissance de l’Imaginaire – 7 février 2026
- Le corps – 7 mars 2026
- Versions politiques contemporaines de la puissance de l’Imaginaire – 13 juin 2026
[1] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Silet », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, leçon du 21/01/95.
[2]Lacan J., Le Séminaire, livre xxiii, Le Sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 150.
[3] Monnier J. L., « Quand la sublimation est évènement de dire », La Cause du désir, no 100, novembre 2018, p. 74-79.
[4] Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », présentation du thème du xe Congrès de l’AMP à Rio en 2016 », Paris, Scilicet, Le corps parlant, l’inconscient au xxie siècle, 2018, p. 21-34.
[5] Laurent É., L’envers de la biopolitique, une écriture pour la jouissance, Paris, Navarin/ le Champ freudien, 2016, p. 93.
[6] Freud S., « Un trouble de mémoire sur l’Acropole », lettre à Romain Rolland, janvier 1936, Résultats, idées, problèmes, t. ii, Paris, PUF, 1985, p. 223.
[7] Miller J.-A., « L’image reine », La Cause du désir, no 108, juillet 2021, p. 25.
[8] Freud S., « La perte de la réalité dans la névrose et dans la psychose », Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1992, p. 299-303.
[9] Miller J.-A., « Une introduction à la lecture du Séminaire vi, Le désir et son interprétation », La Cause du désir, no 86, p. 62-72.
[10] Brousse M.-H., « Politique des identités, politique du symptôme », Ornicar ?, no 53, 2019, Revue du Champ freudien.
[11] Lacan J., « Le phénomène lacanien », Conférence prononcée au Centre Universitaire Méditerranéen de Nice, 30 novembre 1974, texte établi par J.-A. Miller, Nice, Section clinique de Nice, 2011, p. 23.
[12] Miller J.-A., « Effet retour sur la psychose ordinaire », Quarto, no 93-94, janvier 2009, p. 46.
[13] Delarue B., « La théorie du semblant chez Lacan », Suites et variations, année 2022-2023.