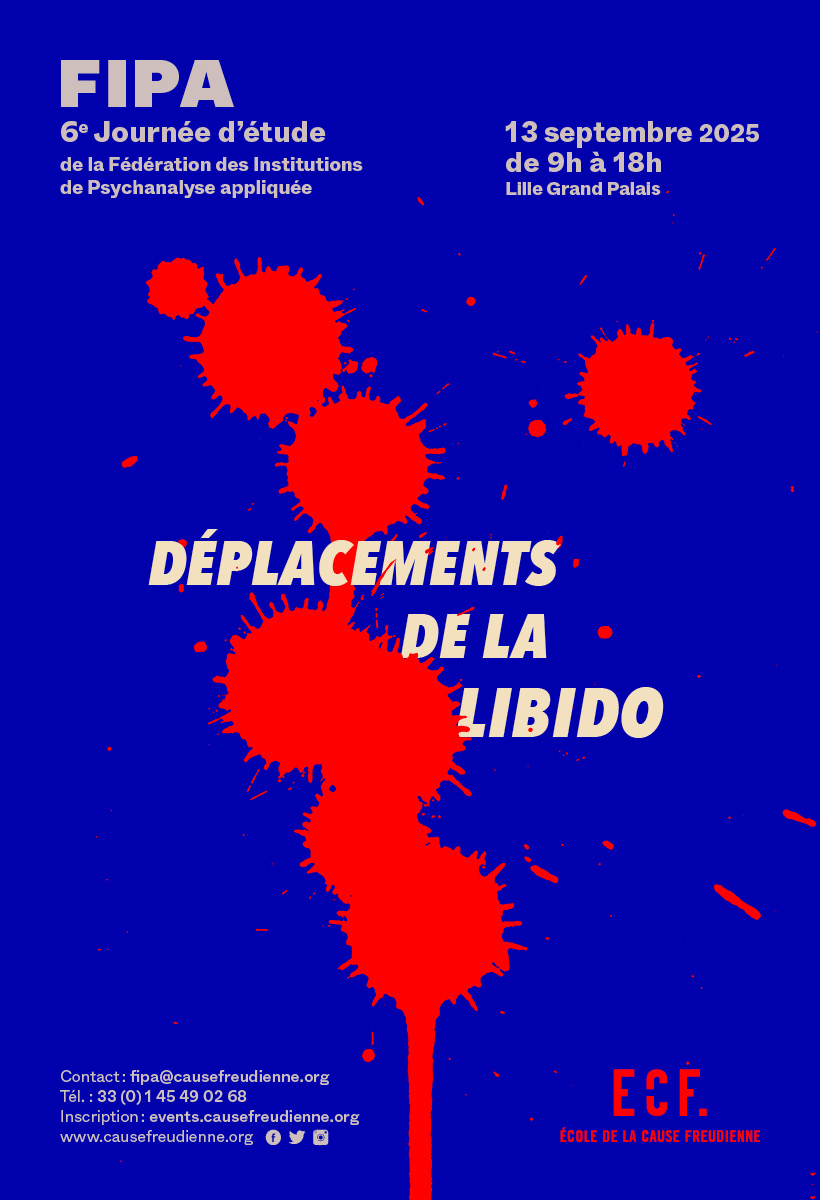Comment s’orienter dans la clinique?
La clinique analytique contemporaine et la puissance de l’imaginaire
Programme de l’année 2025-2026
Durée : 52 heures 30 (14 jours)
Horaires : 21h15-23h15 le vendredi et 10h15-12h15 et 14h-17h30 le samedi
Date :
21-22 novembre 2025
12-13 décembre 2025
9-10 janvier 2026
6-7 février 2026
6-7 mars 2026
12-13 juin 2026
3-4 juillet 2026
Type d’action : Action de formation
Langue : Français
Modalité d’entrée en formation : Admission sur dossier après entretien avec un enseignant.
Contact: Jean Luc Monnier / monnierj@orange.fr / 02 99 79 72 36.
Délai d’accès : Inscription possible jusqu’à 1 mois avant le début de la formation.
Tarif de la formation :
Au titre de la formation permanente : 600€
A titre individuel : 350€
Pour les étudiants de moins de 27 ans (sur justificatifs) et les personnes en recherche d’emploi : 190€
(Association loi 1901 non assujettie à la TVA).
Prérequis : Afin de suivre au mieux l’action de formation sus-mentionnée le stagiaire est informé qu’il est nécessaire d’être au moins du niveau de la 3ème année d’études supérieures après la fin des études secondaires.
Des demandes de dérogation peuvent cependant être faites auprès du secrétariat. Les admissions ne sont prononcées qu’après au moins un entretien du candidat avec un enseignant.
Public : La formation s’adresse aussi bien aux travailleurs de la « santé mentale », psychiatres, médecins, psychologues, orthophonistes, etc. qu’aux psychanalystes eux-mêmes et aux universitaires intéressés par ce savoir particulier.
Accessibilité : Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour les personnes en situation de handicap, merci de contacter notre référent handicap Anne Colombel-Plouzennec au 06 87 49 32 18, afin de vous accompagner et vous orienter au mieux vos démarches et en fonction de vos besoins.
Objectif de la formation et objectifs pédagogiques
Objectif de la formation : Acquérir l’usage des concepts de l’enseignement de Freud et de Lacan pour s’orienter dans la clinique contemporaine au regard de la puissance de l’imaginaire.
Objectifs pédagogiques du programme :
- Comprendre les enjeux de l’imaginaire dans la théorie lacanienne
- Interpréter les enjeux de ce concept aujourd’hui
- Acquérir des outils pour son repérage
- Savoir utiliser ce concept dans la clinique
Contenu de la formation
La clinique analytique contemporaine et la puissance de l’imaginaire
L’argument de Jean Luc Monnier
« L’imaginaire est partout », disait Caroline Doucet alors que nous évoquions ensemble le thème de l’année prochaine. C’est un fait et c’est à tel point que nous ne nous en apercevons pas tant nous y sommes immergés. Même la mort, « quoi qu’on en pense, […] est purement imaginaire [1] ». C’est un peu similaire à la respiration : on doit s’arrêter, pour y penser et s’en faire une idée… fort partielle.
L’imaginaire chez Freud
Freud avait souligné dans plusieurs de ses textes l’importance de l’image. Dans son ouvrage Sur le rêve, il avance : « Le contenu du rêve consiste le plus souvent en situations visualisables ; les pensées du rêve doivent donc tout d’abord recevoir une accommodation qui les rende utilisables pour ce mode de figuration. [2]» Dans un autre grand texte, Psychologie collective et analyse du moi, il avance : « Portée à tous les extrêmes, la foule n’est influencée que par des excitations exagérées. Quiconque veut agir sur elle, n’a pas besoin de donner à ses arguments un caractère logique : il doit présenter des images aux couleurs les plus criardes, exagérer, répéter sans cesse la même chose. [3] »
On sait aussi l’importance qu’il donne à l’image dans cet autre texte intitulé Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci, à tel point que Jacques Lacan dira dans le Séminaire iv que ce texte est « le commencement de la structuration comme telle du registre de l’imaginaire dans l’œuvre freudienne [4] ». C’est en effet, précise-t-il, « la première œuvre où Freud fait mention du terme de narcissisme » [5]. Et sans doute, lorsque l’on évoque Narcisse, devons-nous souligner déjà le lien que l’image entretient avec la pulsion de mort.
L’imaginaire I
Lacan a donné à l’image et par extension à l’imaginaire, – registre qui trouve sa racine dans l’image et plus précisément dans l’image du corps – une place fondatrice.
C’est dire la puissance de l’imaginaire, puisque c’est par le biais de l’image que l’homme au sens générique saisit son corps comme étant le sien. L’image qui s’offre à lui dans le miroir a le pouvoir de lui attribuer son corps et non seulement cela, mais cette image en tant que Gestalt, en tant que forme, « symbolise la permanence mentale du je en même temps qu’elle préfigure sa destination aliénante [6] ». Cela n’est pas sans évoquer ce que Lacan avancera beaucoup plus tard dans le Séminaire Le Sinthome : « Le parlêtre adore son corps, parce qu’il croit qu’il l’a. En réalité, il ne l’a pas, mais son corps est sa seule consistance – consistance mentale, bien entendu [7] ».
Sans doute l’imaginaire n’a-t-il pas eu dans les débuts de l’enseignement de Lacan, où l’on assiste à la promotion en tout du symbolique, la place qui lui reviendra à la fin. En effet Lacan avancera, dans le Séminaire « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre », que l’on « recourt […] à l’imaginaire pour se faire une idée du réel [8] », ce qui met, comme le souligne Jacques-Alain Miller, « le symbolique hors de l’affaire [9] ».
C’est dans ce moment où le réel devient « une idée, une idée limite de ce qui n’a pas de sens [10] », que l’imaginaire se propose comme le registre qui donne la réplique au corps comme trou.
L’imaginaire II
Lacan l’affirme clairement dans une conférence qu’il donna à Nice le 30 novembre 1974 : l’homme « aime son image comme ce qui lui est le plus prochain, c’est-à-dire son corps. Simplement, son corps, il n’en a strictement aucune idée. Il croit que c’est moi. Chacun croit que c’est soi. C’est un trou. Et puis au-dehors, il y a l’image. Et avec cette image, il fait le monde [11] ». Cette proposition peut aussi se lire comme une extension de ce qu’avance Freud dans Totem et Tabou : « l’homme reste, dans une certaine mesure, narcissique après même qu’il a trouvé pour sa libido des objets extérieurs ; mais les forces qui l’attirent vers ces objets sont comme des émanations de la libido qui lui est inhérente [12] ». L’image dont l’être humain fait le monde est une image libidinalisée : son monde étant alors d’une certaine manière une augmentation du moi.
En 1974, le lien de l’image et du corps est toujours aussi serré ; comme dans le stade du miroir, l’image et le corps sont indissociables mais dans un rapport pratiquement inverse. Dans le stade du miroir, le corps est saisi par le sujet à partir de son image dans le miroir alors que dans ce qu’avance Lacan à Nice, l’image vient après le corps. Le corps troué par le signifiant appelle l’image dont on peut supposer la nature contingente. Éclat attaché aux premières significations, outre qu’elle voile le trou du réel, elle donne au parlêtre sa place dans un monde qu’il fait lui-même réalité.
Sans doute ne devons-nous plus nous étonner de la dictature de l’image dans nos sociétés modernes. Sa puissance est là dès le départ, il ne lui manquait que les apports de la science et de la technique pour subvertir et polariser le monde que chacun s’est fait lors de ses premières rencontres avec le signifiant. Le narcissisme se fait alors refuge pour un parlêtre réduit à son image : l’attrait mortifère de l’image prenant là toute sa dimension.
Clinique contemporaine
La pratique de la psychanalyse a toujours affaire à l’imaginaire : comme problème ou comme solution, qu’il soit à exfolier comme Lacan l’avance dans son Séminaire « Le moment de conclure » ou qu’il serve, dans certains cas, à la réparation du nœud. Certes, ce n’est pas le même imaginaire, l’un appartient au premier Lacan et relève de la parole vide, du blabla non exempt de jouissance et l’autre au dernier Lacan et son action réparatrice relève de son accointance avec le réel.
Dans les deux cas sa puissance est incontestable. Obstacle majeur, le transfert en est un exemple explicite, il embolise la cure et condamne l’accès au réel dont il se fait le signe ou bien il s’articule, se construit en logique, à l’instar du fantasme, voire du délire pour cerner, border ce même réel.
Son absence par contraste produit un monde terrible et féroce, certains parlêtres en témoignent. La manœuvre joycienne que Lacan met en évidence est à ce titre éclairante. Il lui est nécessaire d’inventer un usage singulier de l’ego et de son écriture pour raccrocher l’imaginaire au réel et au symbolique, pour réparer le nœud, rattraper ce corps qui s’était détaché et construire un monde.
Ouverture
Lacan à partir de Joyce ouvre la voie d’une clinique du sinthome et des nœuds, dans laquelle l’imaginaire prend une place nouvelle. Il emporte avec lui le vivant dans sa connexion avec le réel, avec le réel du corps vivant.
C’est, me semble-t-il, ce que veut dire l’orientation vers le réel.
Lacan dans Télévision éclaire plus précisément cette expression : « C’est le réel qui permet de dénouer [ce dont] le symptôme [consiste] [13] » et J.-A. Miller le rappelle dans son cours « L’Un- tout-seul » : « c’est énorme, l’idée qu’on puisse opérer avec le réel, que le réel puisse être un moyen de l’opération analytique [14] ».
Cela veut dire, du moins c’est ainsi que nous l’entendons, opérer avec le lapsus du nœud qui inaugure l’inconscient ; opérer avec ce hiatus initial produit par la frappe du signifiant qui troue le corps et se mire dans sa réplique imaginaire. Disons-là que la puissance de l’imaginaire se mesure toujours à l’aune du réel.
Mais Lacan laisse entendre aussi que l’abord de cette nouvelle clinique est ardu : « Les nœuds, ça s’imagine et, plus exactement, ça ne s’imagine pas. Les nœuds sont la chose à quoi l’esprit est le plus rebelle. C’est si peu conforme au côté enveloppé-enveloppant de tout ce qui regarde le corps que je considère que se briser à la pratique des nœuds, c’est briser l’inhibition. L’inhibition : l’imaginaire se formerait d’inhibition mentale. [15] » Gageons que cette nouvelle année de travail nous aidera à nous y retrouver mieux encore dans cette clinique du XXIe siècle.
[1] Lacan J., « Des religions et du réel ». Extrait du discours de clôture des Journées d’études des cartels de l’École freudienne de Paris, le 13 avril 1975, La Cause du désir, no 90, juin 2015, Paris, Navarin éditeur, p. 14.
[2] Freud S., Sur le rêve, Paris, Gallimard, 1988, p. 91-92.
[3] Freud S., « Psychologie collective et Analyse du moi », Essais de psychanalyse, Petite Bibliothèque Payot, p. 134 : « Déjà porté à tous les extrêmes, la foule n’est également stimulée que par des excitations excessives. Qui veut agir sur elle n’a nul besoin de mesurer la logique de ses arguments, il lui faut brosser les tableaux les plus vigoureux, exagérer et toujours répéter la même chose. » https://psychaanalyse.com/pdf/Psycho_collective_analyse_moi_freud_livre_telechargement.pdf
[4] Lacan J., Le Séminaire, livre iv, La Relation d’objet, texte établi par J.-A. Miller Paris, Seuil, 1994, p. 426.
[5] Ibid.
[6] Lacan J., « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 95.
[7] Lacan J., Le Séminaire, livre xxiii, Le Sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 66.
[8] Lacan J., Le Séminaire, livre xxiv, « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre », leçon du 16 novembre 1976, inédit.
[9] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le tout dernier Lacan », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 30 mai 2007, inédit.
[10] Lacan J., « Propos sur l’hystérie », Quarto, no 90, juin 2007, p. 8.
[11] Lacan J., « Le phénomène lacanien », Cahiers cliniques de Nice, no 1, 2011, p. 23.
[12] Freud S., Totem et Tabou, Paris, Payot, 1967, p. 105.
[13] Lacan J., « Télévision », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 516.
[14] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. L’Un-tout-seul », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 25 mai 2011, inédit.
[15] Lacan J., « Conférences dans les universités nord-américaines », Scilicet, no 6-7, Paris, Seuil, 1976, p. 59-60. M.-H. Roch rappelle cette citation dans un article intitulé « Se briser à la pratique des nœuds », Quarto, no 74, p. 48-53.
Programme :
|
Séminaire théorique Vendredi 21h15-23h15 21 novembre 2025; |
Objectifs du module :
Contenu: Novembre : Jean Luc Monnier – Ouverture
|
|
Séminaire pratique Samedi 10h15-12h15 22 novembre 2025;
|
Objectifs du module :
Contenu : |
|
Séminaire de textes Samedi 14h -15h30 22 novembre 2025; |
Objectifs du module :
Contenu : |
|
Argument séminaire texte La clinique analytique contemporaine et les pouvoirs de l’imaginaire
Le narcissisme et ses versions contemporaines Lien de l’imaginaire et de la sublimation Sous l’image, la castration L’objet derrière l’image. Fantasme, délire et puissance de l’imaginaire Le trou dans l’image : après l’évaporation du père retour de l’imaginaire dans le traitement du corps Versions politiques contemporaines de la puissance de l’imaginaire Les six séquences de l’année déclineront :
[1] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Silet », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, leçon du 21/01/95.[2]Lacan J., Le Séminaire, livre xxiii, Le Sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 150.
|
|
Conférences Samedi 15h30 -17h30 22 novembre 2025; |
Objectifs du module :
|
|
22 novembre 2025 – Dalila Arpin |
Organisation de la formation
Équipe pédagogique : Les enseignants, médecins ou psychologues de formation, pratiquent la psychanalyse et sont membres de l’ECF et de l’AMP.
Les Coordinateurs-Enseignants pour la Section clinique de Rennes sont :
o Anne Colombel-Plouzennec – zannec@protonmail.com
o Alice Delarue – alice_delarue@yahoo.fr
o Caroline Doucet – carolinedoucet35@gmail.com
o Thomas Kusmierzyk – thomaskusmierzyk@gmail.com
o Jean Luc Monnier – monnierj@orange.fr
Les enseignants sont tous psychanalystes, membres de l’ECF et de l’AMP :
Romain Aubé
Emmanuelle Borgnis-Desbordes
Damien Botté
Frédérique Bouvet
Dominique Carpentier
Philippe Carpentier
Myriam Chérel
Anne Colombel-Plouzennec
Anne Combot
Alice Delarue
Benoît Delarue,
Jean-Noël Donnart
Caroline Doucet
Marcel Eydoux
Pr Michel Grollier
Pierre-Gilles Guéguen
Noémie Jan
Laetitia Jodeau-Belle
Jeanne Joucla
Thomas Kusmierzyk
Alain Le Bouëtté
Anne-Marie Le Mercier
Pr Jean-Claude Maleval
Martine Marhadour
Pr Sophie Marret-Maleval
Jean Luc Monnier
Ariane Oger
Dr Danièle Olive
Laurent Ottavi
Isabelle Rialet-Meneux
Christelle Sandras
Cécile Wojnarowski
Moyens pédagogiques et techniques :
• Accueil des inscrits dans une salle dédiée à la formation.
• Cours magistraux et exposés théoriques.
• Séminaires pratiques avec exposition et discussion de cas.
• Bibliographie recommandée.
• Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation avec l’application Digiforma :
• Feuilles d’émargement.
• Formulaires d’évaluation de la formation :
o Évaluationdesacquis:questionnaire
o Évaluationdelasatisfaction:
§ À la fin des journées de formation (à chaud).
• Certificat de réalisation de la formation.